Interview : le nouveau livre du frère Alexandre Frezzato
Le frère Alexandre Frezzato est étudiant en licence canonique à l'Université de Fribourg. Il est connu des lecteurs de notre site comme l'un des fondateurs du projet OPChant, qui valorise le chant grégorien selon la tradition dominicaine, et aussi comme l'auteur d'un livre de neuf méditations sur la vie de saint Dominique, paru en février dernier aux Éditions Saint Augustin.
Ce mois, frère Alexandre a publié son deuxième livre, un ouvrage de philosophie et de théologie, aux Éditions du Cerf dans le cadre de leur collection « Cerf Patrimoines ».
La résurrection de la chair selon saint Thomas d'Aquin met son accent sur l’anthropologie de la résurrection et en se concentrant sur l’identité et la continuité de la personne humaine entre la vie présente et la vie ressuscitée. Il porte une introduction de notre frère Gilles Emery, professeur émérite de théologie dogmatique, qui a dirigé le travail du frère Alexandre qui est à la base de ce livre.
Le sujet peut sembler très abstrait, mais, comme nous l'avons découvert lors d’une interview informelle, le frère Alexandre est convaincu que la résurrection de la chair est essentielle à notre compréhension de la nature humaine et du sens de notre vie – tant ici sur terre que dans le monde à venir.
Lisons :
Frère Alexandre, bonjour et félicitations pour ce nouveau livre !
Frère Alexandre Frezzato : Merci… et bonjour !
Alors, Saint Thomas est sûrement un puits de savoir et tant de dominicains ont écrit des travaux et des thèses basées sur ses œuvres. Qu'est-ce qui t'a attiré vers le problème particulier que tu abordes dans ton nouveau livre, à savoir la résurrection des corps ?
AF : Si j'ai décidé d'approfondir la question de la résurrection de la chair dans la doctrine de saint Thomas, c'est non seulement en raison de mon attrait pour la pensée thomasienne, mais surtout en raison d'un constat très simple : beaucoup de catholiques aujourd'hui ont de la peine à croire en la résurrection de la chair alors même que c'est un article de notre Credo et que cela représente une des spécificités caractéristiques de notre foi chrétienne.
Aussi, les prédicateurs évitent bien souvent le thème de la résurrection de la chair tant il est difficile de se représenter la réalité de la vie ressuscitée et la corporéité qui va avec.
C’est vrai…
Je voulais donc creuser ce sujet pour redécouvrir les fondements philosophiques et théologiques d'une question qui manifeste en réalité toute l'anthropologie chrétienne qui devrait habiter la vie des catholiques.
Cela semble être un objectif noble. Eh bien maintenant, en parlant de la résurrection, tu utilises un mot bizarre qui pourrait intimider des lecteurs...
Tu veux dire « hylémorphisme » ?
C'est exact.
Alors, l’hylémorphisme (du grec ancien hylè : matière et morphè : forme) est un concept de philosophie métaphysique selon lequel tout être est indissociablement composé d'une matière et d'une forme, qui composent la substance. Cette pensée a principalement été développée par Aristote.
Très bien, mais ton livre souligne que saint Thomas a utilisé l'hylémorphisme anthropologique d'une manière qu'Aristote aurait ignorée.
AF : Saint Thomas a tiré d’Aristote les principes de son anthropologie hylémorphique, c'est-à-dire qu'il a assumé les concepts philosophiques de la métaphysique aristotélicienne tels que l'être, la substance, l'essence – et surtout l'union substantielle de l'âme et du corps – selon le prisme de « l'information » de l'acte sur la puissance.
Toutefois, comme tu le mentionnes, saint Thomas n'a pas simplement repris ces concepts chez Aristote sans les refaçonner. Ce qui constitue la différence majeure entre Aristote et Thomas est que, chez saint Thomas, tous les concepts de l’anthropologie philosophique servent une théologie, c'est-à-dire une explicitation du mystère de Dieu tel qu'il se révèle dans les Saintes Écritures et la Tradition. Et plus spécifiquement, l'anthropologie thomasienne, à la différence de celle d'Aristote, sert une christologie, c'est-à-dire une explicitation du mystère de la personne du Christ en tant qu'homme (en cherchant à honorer l'intégralité de ce qu'est une personne humaine) et en tant que Dieu (en cherchant à ne rien retirer à la divinité du Christ qu'il partage avec le Père et l'Esprit selon une même nature).
Par contre, l’anthropologie d'Aristote est simplement philosophique : donc les deux pensées ne servent pas le même dessein. Après, il y a de nombreuses différences plus subtiles, mais tout aussi importantes...
Je comprends intuitivement l'intérêt de parler d'union du corps et de l'âme en parlant du Christ, qui est Dieu incarné. Mais permets-moi d'essayer de ramener cette question dans le milieu contemporain.
AF : D’accord…
Il a été observé que notre relation avec notre corps est en train de changer à une époque où la plupart d'entre nous passent la plupart de leurs journées connectés à Internet. Mark Zuckerberg de Facebook vient d’annoncer son projet de construire « le métavers », un monde artificiel en trois dimensions... Penses-tu que le dogme de la résurrection de la chair a quelque chose à dire aujourd’hui ?
AF : C'est intéressant que tu fasses ce rapprochement entre l'actualité cybernétique et le dogme de la résurrection de la chair ! Je pense effectivement que notre confession de la résurrection de la chair peut nous permettre de prendre un sain (et saint) recul par rapport aux propositions présentées comme « innovantes et émancipatrices » par les magnats de l’informatique...
Paradoxalement, le dogme de la résurrection de la chair nous remet les pieds sur terre.
Comment ça ?
AF : Dans la mesure où il nous renvoie aux spécificités de notre foi : l'Incarnation du Christ avant tout, mais aussi l'unicité de ma vie terrestre – donc pas de métempsychose, une idée selon laquelle une même âme peut animer successivement plusieurs corps. Aussi, on se rappelle que dans la vision chrétienne le jugement et le salut engagent la totalité de notre personne, donc âme et corps.
Oui, l'enseignement catholique est que nos corps seront avec nous pour toujours au ciel sous une forme glorifiée après la fin du monde...
AF : Tout comme le corps glorifié du Christ est là maintenant, oui. La vie éternelle doit se passer dans la résurrection de la chair – donc encore une fois, dans la totalité de ce que nous sommes.
Et donc qui sommes-nous ?
Nous sommes en vérité des êtres corporels animés d'un principe spirituel infusé par Dieu et à son image. Donc de ce point de vue, la perspective future « d'exister », « de vivre » et « d'agir » en tant qu'êtres humains incarnés – car c'est ce que nous sommes que nous le voulions ou non – dans un univers complètement désincarné est, selon moi, une grave amputation de ce en quoi devrait consister la vie humaine incarnée.
Monsieur Zuckerberg sera tellement déçu...
AF : (rires) J’imagine bien qu’il ne partage sûrement pas mon avis ! Mais, n’en déplaise au patron de Facebook, j'irais même plus loin en affirmant qu'une existence virtuelle est incompatible avec ce que nous vivrons dans l'au-delà de la mort et de la résurrection, car (que ce soit pour les damnés ou les bienheureux), notre personne tout entière sera opérante et active.
Personnellement, je suis très sceptique par rapport aux promesses humaines de l'évolution technologique du monde virtuel... cela nous coupera non seulement de notre corporéité individuelle, mais aussi de notre anthropologie chrétienne, et... par suite de notre relation avec le Christ...
Il semblerait qu'il y ait ce danger...
AF : D'ailleurs, dans ce fameux « métavers », comment ferons-nous pour recevoir les sacrements… ? Oups, pour cela, il faut être présents en personne, physiquement... C'est déjà un problème qui se pose actuellement durant cette période de pandémie qui entraîne la digitalisation des célébrations sacramentelles...
Certainement…
Et puis, le « métavers », bien qu'il facilitera probablement certaines interactions, est selon moi un leurre : il biaise notre perception de la nature et des besoins d'une personne humaine (un esprit incarné ou une chair animée). Bref, il faudrait développer davantage pour faire le tour de cette question...
Très bien, mais penses-tu qu'un homme du 21e siècle peut honnêtement croire en la résurrection des corps ? N'est-ce pas une sorte de conte de fées ?
AF : Et oui, je pense qu'un homme de notre époque peut croire en la résurrection de la chair, et s'il est catholique, ce n'est pas optionnel. C'est une réalité on ne peut plus biblique si je ne m'abuse...
Que ce dogme soit extrêmement difficile à se représenter rationnellement, je le conçois bien, et c'est normal : il s'agit là d'une réalité révélée qui est objet de foi et non pas le résultat d'une démonstration mathématique... Il faut distinguer les réalités qui sont objets de notre foi et les réalités que nous pouvons « cerner » grâce à notre raison.
Oui, mais comme tu le sais, c'est difficile à vendre maintenant...
Difficile ou facile, j’insiste… La résurrection de la chair est loin d'être un conte de fées, c'est bien au contraire une promesse de vie très concrète dans la mesure où la résurrection du corps est une réalité révélée par le Nouveau Testament et déjà annoncée dans l'Ancien Testament qui déploie la dignité de la vie humaine jusque dans l'éternité.
C'est à la lumière de la résurrection de la chair par la puissance de Dieu et selon l'exemple du Christ que notre vie ici-bas sous la grâce puise sa consistance et son potentiel de sanctification. La résurrection glorieuse de notre personne constitue cette promesse qui rend toute sa saveur à la traversée de notre unique pérégrination terrestre.
Je commence à voir que la résurrection de la chair est loin d'être une question marginale...
AF : En effet, non !
Mais alors, d'après toi, quel serait le public de ce livre ? Qui veut penser à la résurrection de la chair ?
AF : Ce livre s'adresse bien évidemment à tout un chacun s'intéressant à la question de la résurrection de la chair, mais il faut dire que c'est une étude théologique très concentrée. Par conséquent, il nécessite de bons acquis philosophiques, une certaine familiarité avec la pensée de saint Thomas et quelques rudiments de latin (rires). En soi, tout le monde peut l'acheter et s'y risquer...
Que dirais-tu à ceux, y compris ceux de l'Église catholique et ceux de notre propre Ordre, qui pensent que saint Thomas est dépassé et devrait être surmonté par autre chose ?
AF : Au regard de la question précise de la résurrection de la chair, je dirais simplement que saint Thomas et certains penseurs thomistes et thomasiens après lui, présentent les explicitations les plus sûres du point de vue doctrinal et les plus convaincantes.
Lors de cette étude, j'ai lu beaucoup d'autres auteurs sur la question de la résurrection de la chair (en philosophie et en théologie) et il faut avouer que les pistes de réflexion contemporaine à ce sujet sont souvent décevantes. Dès que l'on tente de rendre compte de la résurrection de la chair dans une continuité orthodoxe avec la Tradition catholique à l'aide de conceptions anthropologiques autres que celle d'une métaphysique thomasienne, il faut avouer que c'est peu convaincant et que ça manque bien souvent de réalisme...
Comme il est frappant de voir que tu associes une réalité métaphysique aussi spectaculaire que la résurrection de la chair au mot « réalisme ».
AF : Cela peut sembler frappant, mais c'est de cela qu'il s'agit en définitive pour la théologie catholique : la réalité. Nous croyons aux choses non pas parce qu'elles sont belles mais parce qu'elles sont vraies. C'est aussi honnête que je puisse l'être.
Je te remercie pour ton honnêteté – et pour tes explications, frère Alexandre.
AF : Merci.
La résurrection de la chair selon saint Thomas d'Aquin est en vente sur le site des Éditions du Cerf ou sur Amazon.
Le livre précédent du frère Alexandre, Neuf jours pour découvrir saint Dominique, est disponible aux Éditions Saint Augustin.
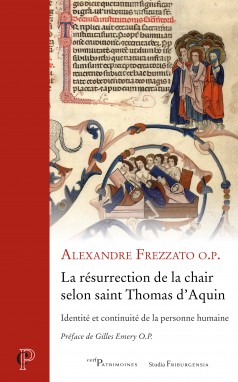
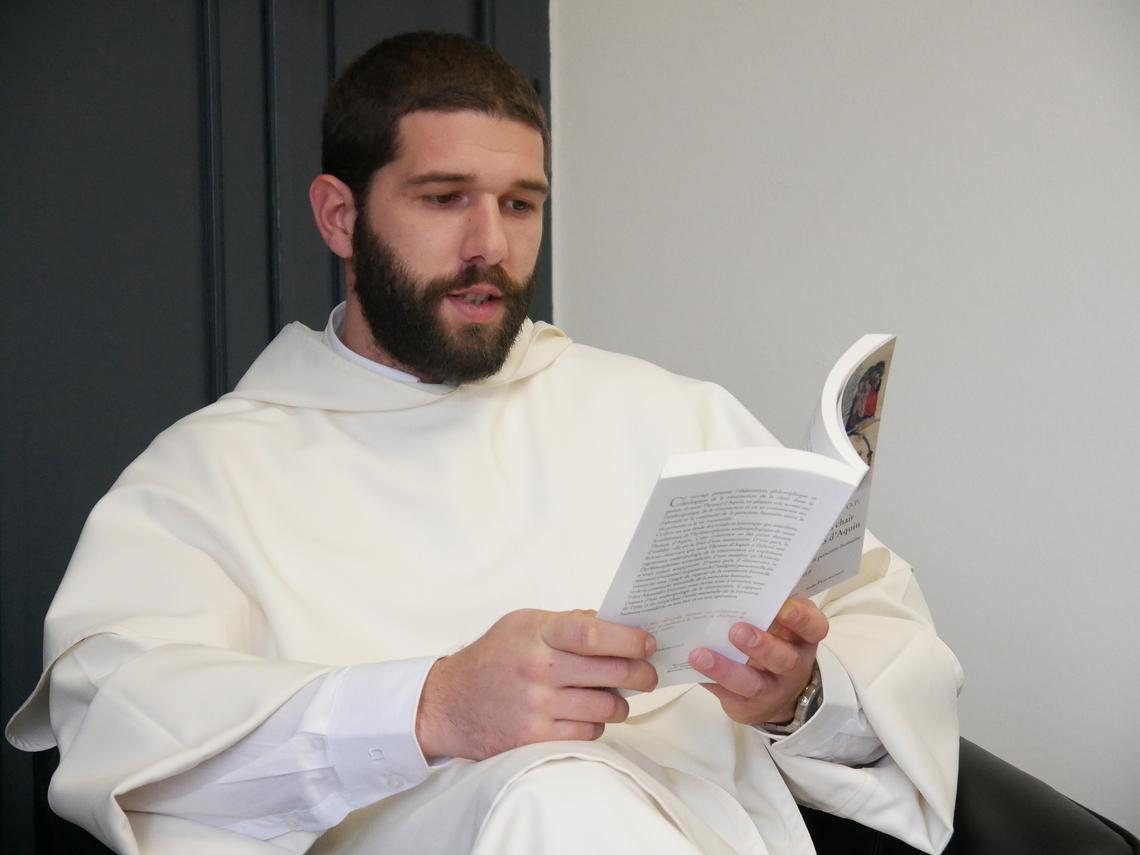
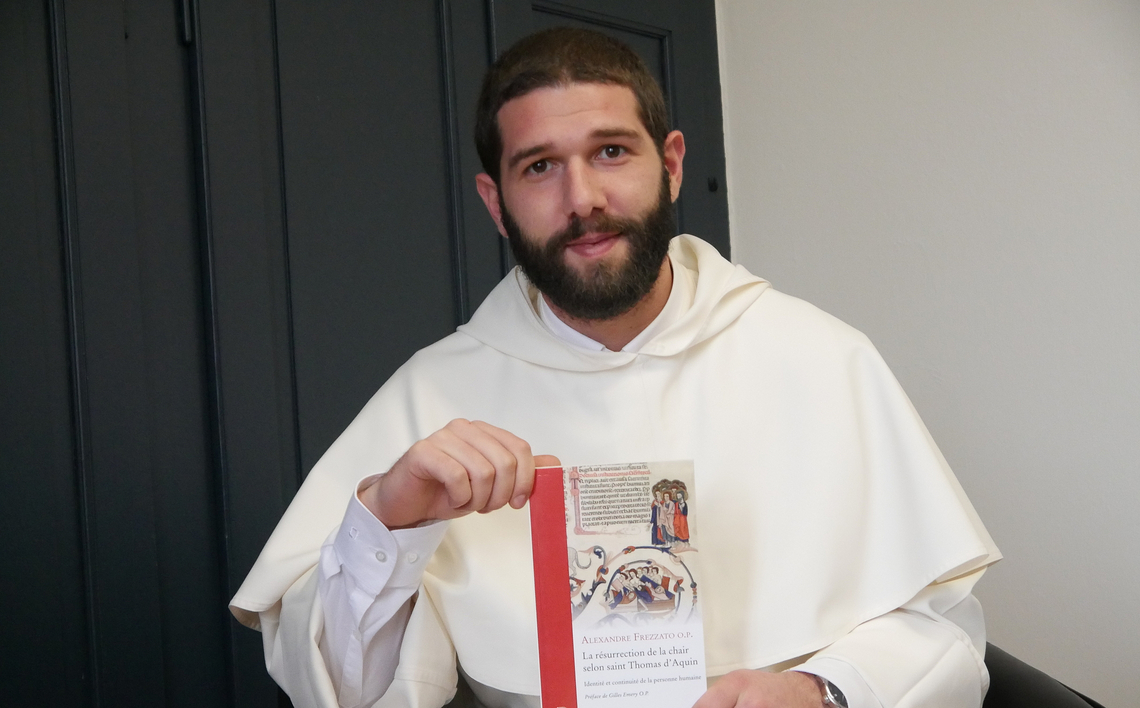


Kommentare und Antworten
Sei der Erste, der kommentiert