Je ne cherchais pas Dieu. C'est Lui qui m'a trouvé
Né à Varsovie en 1992, le frère Tomasz Kucharski a été ordonné prêtre en mai 2021. Il est arrivé à Fribourg en septembre de cette année afin de poursuivre ses études de théologie à l'Université. Le dernier frère polonais qui a vécu avec nous au couvent St-Hyacinthe était le frère Łukasz Wiśniewski, qui est devenu provincial de la Province de Pologne quelques mois seulement après avoir quitté Fribourg. Le frère Tomasz suivra-t-il ses traces ? Nous avons pensé que cette interview pourrait nous éclairer à ce sujet :
La Rédaction : Frère Tomasz, bonjour.
Frère Tomasz Kucharski : Bonjour !
Réd : On me dit que tu viens de Pologne...
TK : C'est en effet le cas ! Je suis né à Varsovie. Et en fait, lorsque j'étais enfant, nous vivions en plein centre de la ville, pas loin d’un couvent dominicain datant du 17ème siècle, qui se trouve dans la partie historique de la ville. Mes parents étaient proches de cette communauté qui anime beaucoup des groupes très actifs. Avec ma grand-mère, ils appartenaient à une communauté de prière charismatique appelée Adonaï. Toute la famille a participé à l'organisation de la messe dominicale des enfants. Ma sœur et moi y avons pris une part active. Par exemple, Agata, déjà à l'âge de 7 ou 8 ans, jouait de l'orgue. Je chantais des psaumes avant même que je ne sache lire. Je devais apprendre par cœur les textes…
Réd : Je pense que c'est la première fois dans nos interviews que nous trouvons un frère qui est pratiquement « né »au couvent ...
TK : (rires) Peut-être bien.
Réd : Mais il y eut sans doute un processus plus long jusqu’au jour où tu as découvert ta vocation dominicaine.
TK : Oui…
Réd : Alors comment as-tu décidé de devenir frère ?
TK : Eh bien, comme je l'ai dit, j'ai toujours connu les Dominicains, même quand j'étais petit. À l'adolescence, comme par hasard, ce sont des frères dominicains qui ont enseigné la religion dans mon école. En Pologne, la religion est enseignée dans les écoles publiques…
Réd : Mais cela n’explique toujours pas pourquoi tu es devenue Dominicain...
TK : Tu as raison. Ces liens étroits avec les Dominicains ne signifient pas du tout que j'ai pensé à rejoindre leur Ordre. En fait, je peux dire que c'est plutôt le contraire.
Réd : C'est vrai ?
TK : Oh oui. Au lycée, j'ai eu une très grave crise de foi. On pourrait même dire que j'ai cessé de croire. Cela était lié aux difficultés que j'avais à trouver ma voie. Dieu n'existait pas dans ma vie, je ne priais pas du tout. J'allais à la messe avec mes parents le dimanche, mais seulement parce que j'avais peur de leur dire que cela n'avait pas de sens pour moi. Mais ensuite, tout a changé. J'ai commencé à étudier les mathématiques à l'Université de Varsovie. À l'époque, ma sœur était très impliquée dans l'aumônerie universitaire dirigée précisément par les frères dominicains. Grâce à elle, j'ai participé à un voyage pour destiné aux nouveaux étudiants. J'ai découvert des gens cool à l'aumônerie, et cela m'a encouragé. J'ai commencé à fréquenter les réunions de l'aumônerie, au début plus pour la compagnie que pour Dieu.
Réd : Beaucoup font pareil, j’imagine.
TK : Peut-être. Mais un grand changement s'est produit lors d'une retraite de trois jours loin de chez moi, au début de l'Avent. C'est là que j'ai ressenti une touche très puissante de la part de Dieu. Soudain, j'ai commencé à prier tous les jours, à regarder le monde différemment, à voir que Dieu est près de moi et qu'Il m'aime…
La prise d'habit par le frère Tomasz et d'autres novices en 2014 a été filmée et transformée en cette vidéo par les frères en Pologne :
Réd : Peux-tu décrire exactement ce que tu entends par « touche » ?
TK : Honnêtement, non, je ne peux pas. J'ai ressenti sa présence d'une manière très subtile, mais je n’en avais pris l’initiative. Ce n'était pas encore un appel précis, mais un prélude. J'étais perdu, je ne cherchais pas Dieu, je ne voulais pas être piégé, mais c'est Lui-même qui m'a trouvé.
Réd : Et te voilà à Fribourg. Quel genre d'études poursuis-tu actuellement ?
TK : Je suis venu à Fribourg pour rédiger ma thèse de doctorat. Je m'intéresse au thème de la grâce. Dans mon travail de Master, que j'ai rédigé à Cracovie, je suis parti d'un problème assez simple : que signifie « s'ouvrir à la grâce » ou « coopérer avec la grâce » ? C'est quelque chose que l'on entend souvent dans l'Église mais je trouvais que ce n'était pas clair du tout.
Réd : Les gens disent cela sans savoir ce qu'ils veulent dire, je pense...
TK : J'ai donc décidé d'écrire un mémoire intitulé « Qu'est-ce que la grâce ? » Il s’agit d’une analyse de la question 110 de la Prima secunade de la Somme de théologie de saint Thomas d'Aquin. Ce travail s'est avéré fructueux, non seulement en tant que projet académique mais aussi pour ma foi et ma vie spirituelle. Je suis donc resté sur ce sujet et je veux écrire une thèse sur la grâce. La différence est qu'à Cracovie, je me concentrais principalement sur saint Thomas, alors que maintenant je me tourne vers Thomas de Vio, connu sous le nom de Cajetan.
Réd : Qui est-ce ?
TK : C'est un dominicain qui a vécu aux 15e et 16e siècles. Il a développé la pensée de saint Thomas. Après mes recherches actuelles à Fribourg, je pense que je pourrais transmettre mes connaissances en Pologne.
Réd : En attendant, tu es assez loin de la Pologne, du moins culturellement...
TK : (rires) Oui. Au couvent de St-Hyacinthe, on est partout à la fois. Actuellement, le couvent abrite des frères de cinq continents. Il ne manque que l'Amérique du Sud et l'Antarctique. Pour moi, c'est une vraie expérience.
Réd : Comment ça ?
TK : Eh bien, avant la Seconde Guerre mondiale, la Pologne était une société multiculturelle, avec des minorités importantes de Lituaniens, de Ruthéniens, d'Ukrainiens, d'Allemands, de Juifs, d'Arméniens et autres. Mais après la guerre et le changement de frontières imposé à la Pologne par l'Union soviétique, il y eut des déplacements de population. Les Juifs ont été exterminés. Les Allemands restés en Pologne ont été déplacés de force, principalement vers ce qui est devenu l'Allemagne de l'Est. Ainsi, la Pologne est devenue une nation quasi-monoculturelle. Presque tout le monde en Pologne a une origine ethnique polonaise et parle polonais. Et jusqu'à très récemment, l'écrasante majorité des Polonais étaient catholiques.
Réd : Est-ce que cela change maintenant ?
TK : Le catholicisme est toujours la religion majoritaire. Mais des changements socio-religieux rapides ont lieu actuellement dans notre pays.
Réd : Pourquoi cela ?
TK : Très brièvement, le rôle de l'Église dans la politique a changé. La place de la foi catholique dans l'identité des gens a évolué. Jusqu'à la fin des années 80, pendant le communisme, l'adhésion à l'église était une forme d'opposition au système. Les réunions de dissidents et d'artistes qui critiquaient le régime avaient lieu dans des églises et des cloîtres, par exemple. Maintenant, heureusement, le communisme a disparu de notre pays. Mais il s'est avéré qu'avec la liberté retrouvée, beaucoup ont abandonné la foi. Je pense que c'est parce que l'Église n'était plus nécessaire pour construire une identité. Certains identifient même l'Église au régime politique actuel, ce qui est dangereux pour l'Église et handicape notre prédication...
Réd : On connait la chanson. On pense à l'Espagne, l'Italie, l'Irlande...
TK : Eh bien, la Pologne est différente sur certains points importants, mais oui, il y a aussi des similitudes. En termes de statistiques, les pratiquants sont encore plus nombreux en Pologne que dans le reste de l’Europe. À Szczecin, où j'ai vécu l'année dernière, nous avions huit messes dans notre paroisse chaque dimanche et une le samedi soir, sans compter les messes organisées par le Chemin Néocatéchuménal. C’est inimaginable à Fribourg. Mais le nombre de fidèles est en baisse et l'Église en est au moins en partie responsable.
Réd : C’est vrai ?
TK : L'Église est accusée, à juste titre, d'être trop liée à des questions politiques. Cela énerve beaucoup les gens quand on parle de politique dans un sermon, par exemple, au lieu de l'Évangile. Il y a aussi des critiques selon lesquelles les prêtres sont trop orientés vers l'argent. Ensuite, des scandales sexuels ont été révélés, y compris ceux qui impliquent la pédophilie, et cela a poussé de nombreuses personnes à s'éloigner. Il y a un manque de zèle, je dirais. En plus, on ne sait pas porter l'Évangile à l'intelligentsia. On préfère la piété populaire. En tant que Dominicains en Pologne nous devons trouver de nouvelles manières de prêcher l'Évangile.
Dans cette vidéo, le frère Tomasz préside une akathiste (hymne récité par les chrétiens orientaux) à la louange du Saint-Esprit. Le nom vient akathiste du fait que pendant le chant de l'hymne la congrégation doit rester debout (ἀ-, a-, « sans, pas » et κάθισις, káthisis, « assis ») :
Réd : Ne penses-tu pas que ton séjour à Fribourg pourrait t'aider à découvrir certaines de ces nouvelles façons ?
TK : Absolument. Au couvent St-Hyacinthe, j'ai l'occasion de vivre avec des frères d'autres provinces qui ont l'expérience d’une Église minoritaire. Dans un avenir pas si lointain, nous nous retrouverons dans une situation similaire. Il vaut donc la peine d'apprendre des autres.
Réd : Tu es là seulement pour quelques années, et tu prévois de retourner en Pologne. Comment conçois-tu ton avenir ?
TK : Nous ne pouvons pas changer toute la société du jour au lendemain. Ce que nous pouvons faire, c'est simplement nous convertir. La sainteté est la forme la plus puissante de témoigner. Je n'ai pas d'influence sur l'ensemble de l'Église. Je peux simplement m'occuper de la petite Église que j'ai autour de moi. Honnêtement, je ne suis pas très inquiet pour l'avenir. Bien sûr, l'Église sera de plus en plus minoritaire. Mais même maintenant, on peut voir un côté positif de cette situation : il y a moins de gens qui viennent à l'église par routine. Ceux qui sont dans l'Église croient vraiment. Ils ont choisi librement de cultiver une relation avec Jésus. Je constate que ces gens sont capables de parler de leur foi. Ils sont intellectuellement engagés et ils réussissent à rendre raison de leur foi, alors que leurs parents ne le faisaient pas. Peut-être qu'à l'avenir, l'Église ne sera pas grande, mais elle sera une communauté ardente.
Réd : Nous pouvons l'espérer. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui, frère Tomasz.
TK : Merci.
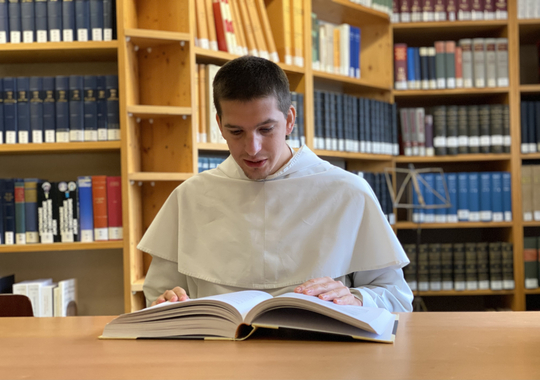




Kommentare und Antworten
Sei der Erste, der kommentiert