Interview d'auteur
Dans L'Église catholique est-elle anticapitaliste ? (Editions de SciencesPo, Paris 2019) frère Jacques-Benoît Rauscher considère l'enseignement de l'Église sur l'économie au cours des 130 dernières années. Le frère Jacques-Benoît est docteur en sociologie, agrégé de sciences économiques et sociales et diplômé de Sciences Po. Il travaille à l'Université de Fribourg où il prépare un doctorat en théologie.
Il a parlé hier à la rédaction de notre site au Couvent St-Hyacinthe à Fribourg :
Ton nouveau livre parle des relations entre l'Église catholique et le capitalisme. Tu fais référence aux documents de la doctrine sociale de l'Église à partir du pontificat de Léon XIII, qui s'est terminé en 1903. Depuis lors, certains papes n'ont pas écrit sur l'économie, d'autres l'ont fait, mais de manière indirecte ou ambiguë. Plusieurs documents ont été produits par les congrégations de la curie romaine, mais ils ne sont pas beaucoup plus clairs. Qu'est-ce qui t'a inspiré à revenir sur ces questions maintenant ?
Ce qui m’a poussé à explorer ces questions est tout d’abord un constat très pratique. Alors que l’Église indique avoir une doctrine sur toutes ces questions, celle-ci est très peu connue et très peu discutée à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Église. Il existe aujourd’hui de bons outils (le Compendium de la Doctrine sociale publié en 2005), de bons ouvrages et des parcours de formations pour s’initier à ces textes pontificaux. Pourtant, la Doctrine sociale de l’Église reste « le secret le mieux gardé » de l’Église comme le déplore le Cardinal Turckson, pourtant chargé de ces questions à Rome. Mon idée est que cela ne vient pas seulement d’un défaut de communication ou de transmission, mais d’un contenu dans lequel on peine à se retrouver tant il apparaît éclectique sur le plan théorique… et cela transparaît tout particulièrement à propos du capitalisme.
La doctrine sociale de l'Église est-elle suffisamment claire sur le capitalisme ? Quelles sont les valeurs fondamentales que l'Église peut appliquer pour évaluer des systèmes économiques ?
On a longtemps fait le reproche à la Doctrine sociale de l’Église de n’être pas assez claire sur le capitalisme. En un sens, cela est vrai car il y a longtemps eu une crainte de la part de l’Église qu’une critique trop ferme du capitalisme soit interprétée comme une porte ouverte au marxisme. Mais, en 1991, Saint Jean-Paul II publie un texte sans ambiguïté sur la question. Il propose de réserver l’appellation « capitalisme » aux fondements moraux que présuppose ce système économique et rejette nettement ces derniers, très inspirés par une vision de l’homme problématique pour un chrétien.
Comme d'autres écrivains catholiques tu fais la distinction entre le capitalisme et un système de marché libre. Peut-être que cette distinction n’est pas très claire dans toutes les cultures et toutes les langues. Peux-tu nous expliquer la différence ?
La distinction est précisément posée par Saint Jean-Paul II dans l’encyclique Centesimus Annus. Le pape indique que l’économie de marché ou l’économie libre désigne d’abord un système économique où l’entreprise, la propriété, la créativité libre jouent un rôle important. Ces différents éléments sont tout à fait positifs et, on pourrait ajouter avec Jean XXIII, que là où ces éléments ont fait défaut, c’est la pauvreté qui a prévalu. En revanche, le capitalisme désigne sous la plume de Jean-Paul II un système de pensée où la liberté économique n’est pas encadrée par un cadre juridique et où les règles du marché dominent sur des individus, poussés à rechercher leur intérêt individuel. Ce système de pensée est contraire à la vision chrétienne de l’homme.
Tu es docteur en sociologie agrégé de sciences économiques, mais beaucoup de prêtres n'ont aucune formation en sociologie ou en économie. As-tu remarqué ce manque ? Quel effet cela pourrait-il avoir sur la façon dont l'Église envisage l'argent et le marché ?
Je suis personnellement heureux d’avoir eu une formation dans un domaine profane avant d’être devenu religieux et prêtre. C’est mon chemin particulier, je ne saurais dire que c’est un modèle que tous doivent suivre ! Mais je crois que ce qui est important est moins la formation antérieure que l’on a reçue que la capacité d’ouverture que l’on est capable de développer. Le grand piège est toujours de vouloir réduire la complexité des évènements et des personnes à quelques principes simples. Ce piège, on peut y tomber dans le domaine de l’économie, de la sociologie, comme en étant prêtre…
Le système économique semble changer très rapidement et est plus mondialisé que jamais. Des pays autrefois marginalisés, tels que l’Inde et la Chine, jouent désormais un rôle de premier plan. Comment l'Église pourrait-elle réagir à la nouvelle situation ?
Nous vivons une période de changements de très grande ampleur dont nous peinons sans doute à mesurer toutes les conséquences. Parmi ceux-ci, il y a effectivement ce que l’on pourrait appeler le phénomène de « marginalisation de l’Occident ». L’Europe et les Etats-Unis, deux entités très profondément marquées par le christianisme, voient leur rôle s’amoindrir sur la scène mondiale, même s’il faudrait relativiser ce déclin qui ne concerne que certaines dimensions. L'Église catholique, qui se lit souvent comme étant historiquement très liée au monde occidental, est peut-être invitée par cette évolution à découvrir sa dimension proprement universelle. Le risque pour l'Église peut être, dans ce contexte, de se cloisonner dans le rôle de dernière gardienne du monde occidental au lieu de s’ouvrir au renouveau et à la mission. La chance de l'Église est néanmoins de pouvoir s’appuyer sur une Tradition de plusieurs millénaires et sur la promesse du Christ qui devrait lui faire envisager l’avenir et les changements qui se présentent avec espérance. L'Église sait, en effet, que beaucoup de choses peuvent changer, mais qu’elle ne pourra jamais perdre l’essentiel.
Quel genre de système économique aimerais-tu voir ? Comment pouvons-nous réaliser la prospérité d'un grand nombre tout en assurant la solidarité et un traitement humain de chaque personne ?
Il m’est difficile de répondre à une question aussi complexe en quelques mots : je n’ai pas de solutions miracles ! Il me semble que dans le domaine économique deux écueils nous menacent. Le premier consiste à éviter toute réflexion morale en se focalisant uniquement sur les résultats économiques et le bien-être matériel auquel ils peuvent concourrir. L’autre écueil, plus subtil, consiste à rejeter le monde tel qu’il est et à penser que seules des formes alternatives de vie peuvent satisfaire le chrétien soucieux de mener une existence en cohérence avec sa foi. Dans l’Evangile, Jésus nous dit : « Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles ». (Lc 16,9). C’est une phrase à méditer : à la fois, Jésus nous rappelle que l’argent est bien trompeur ; d’un autre côté, il nous dit que c’est dans la mesure où nous aurons su agir avec prudence dans le monde tel qu’il est que nous seront ouvertes les portes de l’éternité !
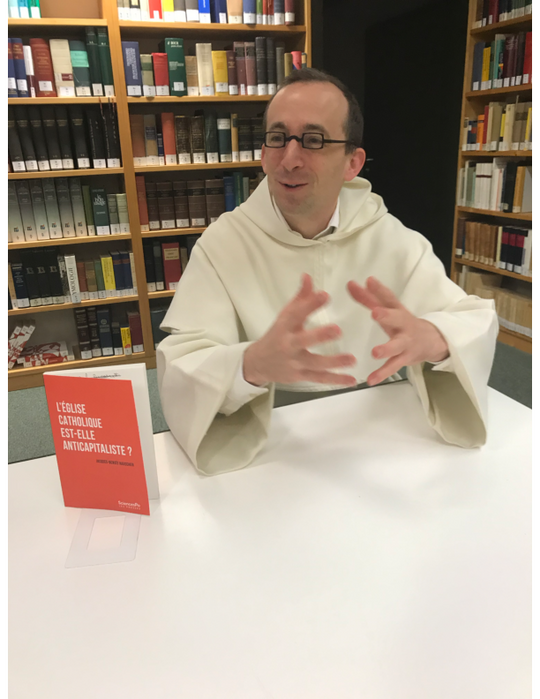
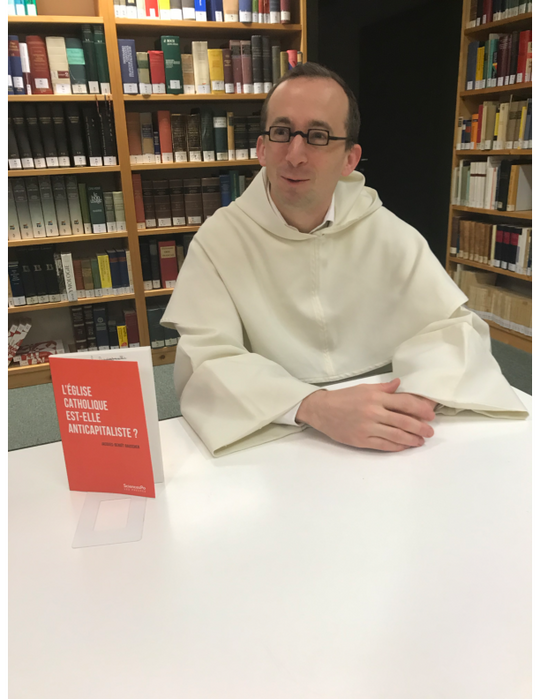
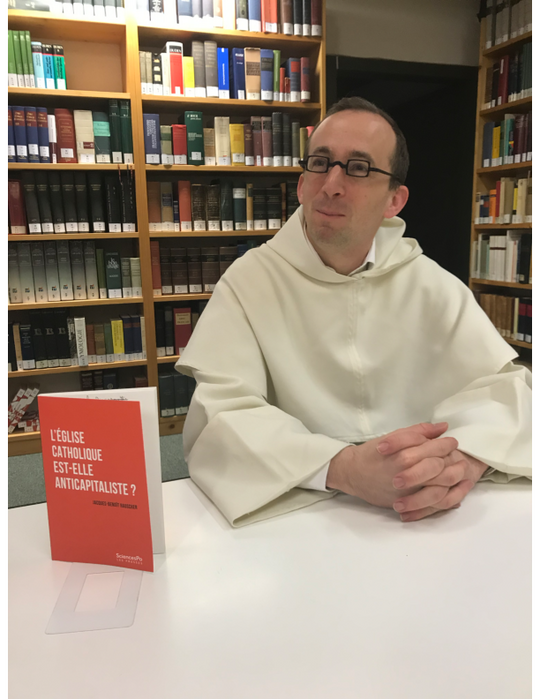
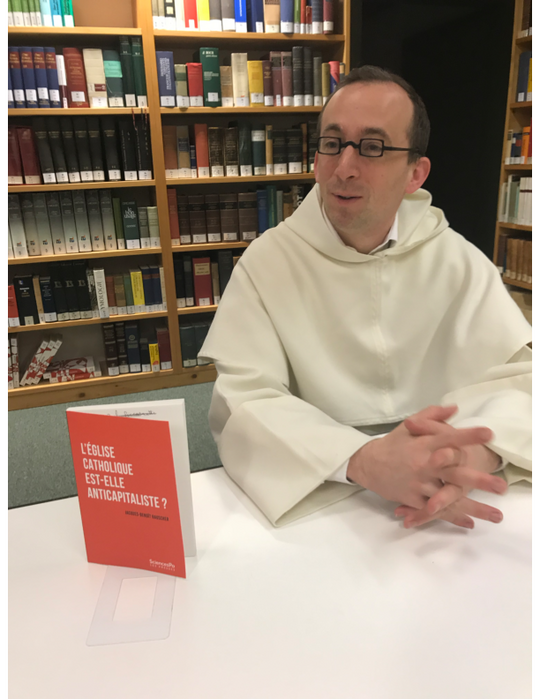
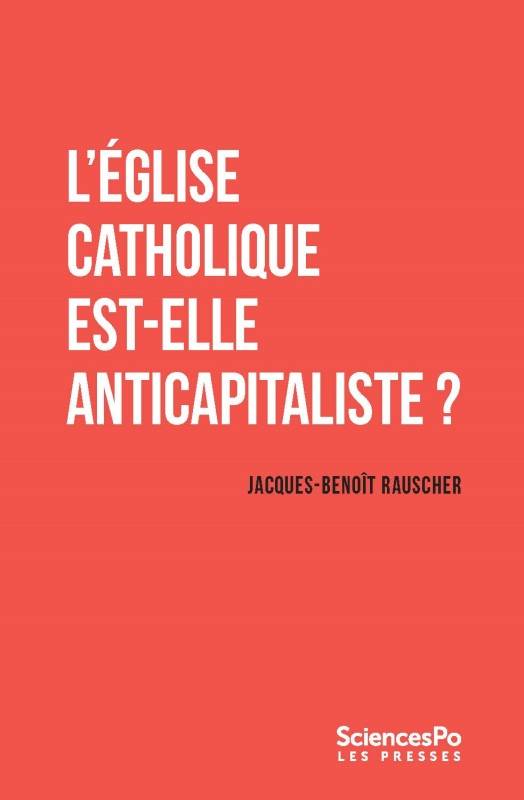
Kommentare und Antworten
Sei der Erste, der kommentiert